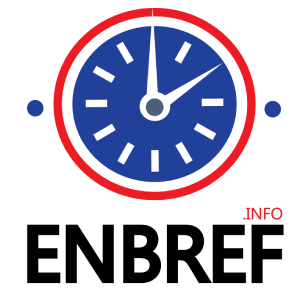Chaque époque a ses épreuves. Pour Haïti, l’heure n’est plus aux réformes hésitantes ni aux discours en demi-teinte. C’est une bataille existentielle qui se joue : retrouver la souveraineté perdue face aux gangs criminels. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé l’a compris et ne cesse de le répéter : son mandat ne sera jugé qu’à l’aune d’un seul critère — sa capacité à récupérer les territoires perdus et à rendre justice à un peuple martyrisé.
Cette détermination est nouvelle. Trop souvent, les dirigeants haïtiens se sont contentés d’annonces spectaculaires, d’opérations ponctuelles sans lendemain et de négociations stériles avec des forces qui, au fond, défiaient l’État sans crainte. Résultat : un effondrement progressif de la République, jusqu’à ce constat glaçant — plus de 90 % de la capitale sous contrôle des gangs, des milliers de déplacés, une économie paralysée, une population en otage.
Face à ce désastre, le Premier ministre n’a pas choisi la langue de bois. Son credo est clair : aucun compromis avec les criminels, aucun recul face à la terreur. Chaque kilomètre repris est une victoire de la République. Chaque quartier libéré est un hommage aux familles meurtries. Chaque axe routier rouvert est une promesse tenue au peuple haïtien.
L’histoire récente est marquée par une série d’occasions manquées. Après la fin de la mission onusienne MINUSTAH en 2017, les gouvernements successifs ont laissé prospérer les gangs. Plutôt que de renforcer la police nationale et d’investir dans la sécurité, on a multiplié les compromis, les clientélismes et les arrangements douteux. Les criminels sont devenus des acteurs politiques de facto, capables de bloquer la capitale, de rançonner les ports, et de défier l’État en plein jour. La société civile n’a cessé de dénoncer cette complaisance. Mais les élites ont trop souvent détourné le regard, profitant de leur capacité à quitter le pays ou à se protéger dans des enclaves sécurisées. Le peuple, lui, n’avait pas d’échappatoire. Ce sont les enfants de Carrefour-Feuilles, de Martissant ou de Cité Soleil qui ont payé le prix fort : enlèvements, viols, massacres, famine. Une décennie perdue, où l’État a reculé pas à pas, jusqu’à l’effondrement.
Dans ce contexte, la posture du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé marque une rupture. Dès son arrivée, il a fixé un cap : la reconquête des territoires par tous les moyens nécessaires. Le gouvernement a lancé des initiatives multiples, allant du redéploiement d’unités spéciales sur les axes stratégiques, à la coopération accrue avec les pays de la région et les partenaires internationaux, en passant par le recours à des sociétés privées comme Vectus Global, chargées d’appuyer les opérations sécuritaires et la modernisation de la fiscalité. En parallèle, des soldats sont formés à l’étranger, notamment au Mexique, pour renforcer les capacités opérationnelles nationales. Selon une source proche de la Primature, un objectif concret est prioritaire : rouvrir d’ici fin septembre au moins une grande route nationale reliant Port-au-Prince au Grand Nord ou au Grand Sud. Derrière ce calendrier, il y a plus qu’un enjeu logistique : c’est une bataille symbolique. Rouvrir un corridor majeur, c’est signifier au peuple et au monde que l’État reprend l’initiative et qu’Haïti refuse de se résigner.
Personne ne sous-estime la difficulté de ce pari. Les gangs disposent d’armes sophistiquées, souvent supérieures à celles de la police. Ils s’appuient sur des réseaux de financement puissants, incluant le trafic de drogue et les contrebandes. Ils connaissent le terrain mieux que quiconque, et exploitent la misère pour recruter parmi les jeunes désœuvrés. Les récents drames rappellent combien la bataille est asymétrique. Deux policiers d’élite de la SWAT sont tombés sous les balles, victimes d’une embuscade meurtrière. Un drone piégé a explosé sur une base de la police à Kenscoff, tuant et blessant plusieurs agents. Ces événements montrent que les gangs innovent, se militarisent, et n’hésitent plus à cibler directement les forces de l’ordre. Et pourtant, malgré ce rapport de force défavorable, le gouvernement persiste. Parce qu’il sait que la survie de l’État en dépend.
Dans les rues, le discours du Premier ministre résonne. De nombreux citoyens saluent sa fermeté. « C’est la première fois depuis longtemps qu’un chef de gouvernement parle ouvertement de reconquête et de justice », confie un habitant de Carrefour-Feuilles. « On sent qu’il veut vraiment agir, même si la tâche est immense. » Des acteurs de la société civile observent également un changement. Pour la première fois depuis des années, le gouvernement semble avancer dans une même direction, avec un cap clair. Un sociologue de Port-au-Prince analyse : « Ce n’est pas seulement une question de sécurité. C’est une question de dignité. Le Premier ministre a compris que la sécurité est la condition de tout le reste : l’éducation, l’économie, la démocratie. »
La détermination du gouvernement haïtien ne passe pas inaperçue à l’étranger. Les partenaires internationaux, longtemps accusés de passivité ou de calculs géopolitiques, semblent désormais alignés sur la priorité sécuritaire. Le Bureau of Western Hemisphere Affairs du Département d’État américain a publié plusieurs messages clairs : les gangs qui déstabilisent Haïti sont dans le viseur de Washington. Christopher Landau, ancien ambassadeur et actuel secrétaire d’État adjoint des États-Unis, a affirmé que « les États-Unis utiliseront tous les outils disponibles pour écraser ces criminels ». Il a rappelé que lorsque Washington vise une organisation terroriste, « il ne manque pas sa cible ».
Le Département d’État a même annoncé une récompense de 5 millions de dollars pour toute information menant à la capture de Jimmy “Barbecue” Chérizier, présenté comme le chef d’une organisation criminelle responsable d’un règne de terreur. Plusieurs visas et cartes vertes ont déjà été annulés pour ses complices, en Haïti comme aux États-Unis. Le 1er août, les États-Unis ont aussi félicité les membres du Conseil présidentiel de transition pour avoir rejeté les tentatives de corruption, réaffirmant leur collaboration directe avec le Premier ministre.
Enfin, après la mort des deux policiers de la SWAT, Christopher Landau a appelé personnellement Alix Didier Fils-Aimé pour lui présenter ses condoléances et assurer que « les États-Unis et de nombreuses nations se tiennent aux côtés de ceux qui cherchent à restaurer la loi et l’ordre en Haïti ».
Ces messages ne sont pas anecdotiques. Ils montrent que le combat du Premier ministre est reconnu, appuyé et inscrit dans une dynamique régionale et mondiale.
Reste que le succès ou l’échec du gouvernement se jouera dans les prochains mois. Si, d’ici fin septembre, un grand axe routier est effectivement rouvert et sécurisé, ce sera une victoire stratégique et symbolique. Stratégique, parce que cela facilitera les échanges économiques et redonnera de l’oxygène au pays. Symbolique, parce que cela prouvera que l’État n’a pas renoncé à son autorité. Mais si cet objectif n’est pas atteint, la désillusion pourrait être fatale. La population, lassée de promesses non tenues, risque de perdre définitivement confiance. Et les gangs, enhardis, pourraient étendre encore leur emprise. Le Premier ministre joue donc sa crédibilité, mais aussi celle de l’État haïtien tout entier.
La grande différence avec les gouvernements précédents, c’est que le Premier ministre actuel ne parle pas de compromis ni de transition molle. Il parle de reconquête. Ce mot est lourd d’histoire, mais il traduit une réalité : Haïti ne peut pas avancer tant qu’elle n’a pas récupéré son territoire. Là où d’autres se sont réfugiés dans les calculs politiques, lui a choisi de prendre le risque de l’action. Il sait que ce combat est difficile, qu’il coûtera cher en vies humaines et en ressources. Mais il sait aussi qu’il n’y a pas d’alternative. Soit l’État reprend le dessus, soit il disparaît.
Si Alix Didier Fils-Aimé réussit ne serait-ce qu’à rouvrir un axe majeur et à sécuriser durablement certains quartiers, il aura marqué un tournant. Son nom restera celui d’un Premier ministre qui, dans l’une des pires périodes de l’histoire haïtienne, a osé défier la peur et brandir la souveraineté de la République comme étendard. Il n’a pas choisi la facilité. Il a choisi la voie de la justice, de la reconquête, et de la dignité. Pour un peuple trop longtemps trahi, trop longtemps abandonné, cette rupture était nécessaire.
Haïti n’a plus de temps à perdre. La bataille engagée aujourd’hui décidera de l’avenir d’une génération. Et le Premier ministre le sait : il joue sa place dans l’histoire non pas sur des discours, mais sur sa capacité à libérer la nation du joug des gangs et à redonner aux Haïtiens ce droit fondamental — celui de vivre libres sur leur propre sol.